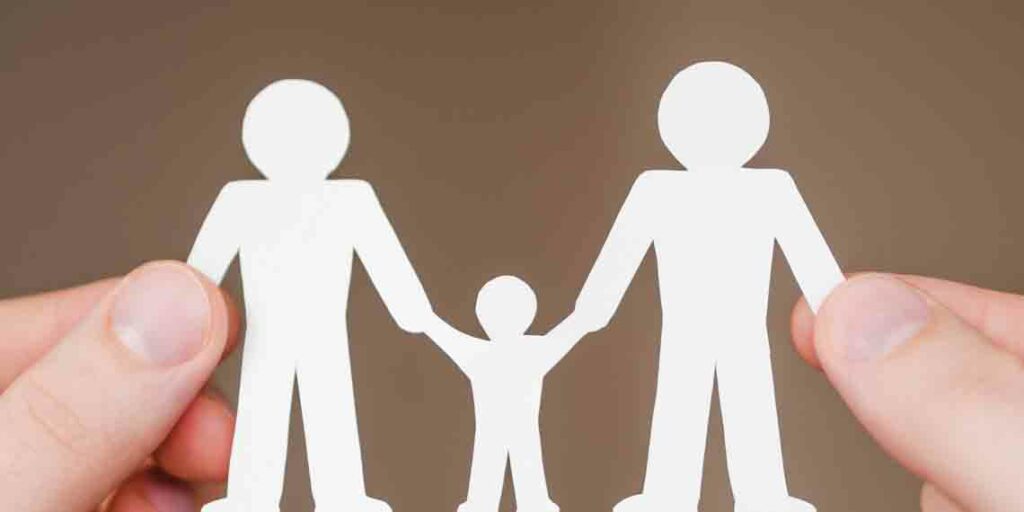Malgré la montée des discours anti-immigration, le gouvernement français a officiellement réaffirmé que la kafala judiciaire reste reconnue comme forme légitime de tutelle pour les enfants algériens. Ce maintien permet de garantir le droit au regroupement familial en France par Kafala et, dans certains cas, l’accès à la nationalité française.
Dans un climat politique tendu en France autour des questions migratoires, la kafala, forme de tutelle judiciaire islamique sans lien de filiation a récemment fait l’objet d’une interpellation officielle à l’Assemblée nationale. Le député Christian Girard, membre du Rassemblement National, a dénoncé ce qu’il qualifie de “stratégie d’évitement” des règles classiques de l’immigration à travers l’usage de la kafala par des familles algériennes souhaitant faire venir des enfants mineurs sur le territoire français.
Le ministère de l’Intérieur a répondu le 17 juin 2025 à cette interpellation par une position mesurée mais ferme, la France ne prévoit pas de remettre en cause le recours à la kafala dans le cadre du regroupement familial. Cette pratique reste reconnue comme un mode légitime de prise en charge des mineurs, en particulier dans le cadre de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Regroupement familial en France par Kafala, un cadre légal
La kafala n’est pas une adoption au sens du droit français. Elle n’établit pas de lien de filiation, ni de droits successoraux, mais elle transfère temporairement l’autorité parentale à un tuteur nommé par décision judiciaire. Cette distinction permet à la France de reconnaître la kafala comme un acte civil valable, notamment pour autoriser le regroupement familial de l’enfant avec le tuteur, sans remettre en cause les principes du droit national.
Dans sa réponse écrite, le ministère précise que cette reconnaissance est strictement encadrée : la kafala doit être prononcée par un juge, être exécutée de manière effective, et ne concerne pas les parents biologiques ni leurs conjoints. Elle ne confère pas non plus un droit automatique à un titre de séjour ni à l’aide sociale, mais peut permettre, sous conditions, une naturalisation.

Naturalisation par kafala : peu de cas, beaucoup de fantasmes
L’article 21-12 du Code civil permet à un enfant recueilli en France par kafala d’acquérir la nationalité française, à condition qu’il ait été confié à un ressortissant français par kafala judiciaire depuis au moins trois ans. Cette disposition est régulièrement critiquée par certains courants politiques, qui dénoncent une “faille” dans le dispositif de contrôle migratoire.
Pourtant, les chiffres sont loin de confirmer ces accusations. Selon les données du ministère de l’Intérieur, moins de 30 cas de naturalisation par kafala sont enregistrés chaque année entre 2019 et 2024. Ces chiffres démentent l’existence d’un prétendu afflux massif, souvent relayé à tort dans les débats politiques et médiatiques.
La kafala en France : ce que dit précisément la loi sur l’accès à la nationalité
L’article 21-12 du Code civil permet en effet à un enfant mineur recueilli par kafala d’obtenir la nationalité française par déclaration, à condition de remplir plusieurs critères stricts. La kafala doit être prononcée par un tribunal, qu’il soit français ou étranger, et l’enfant doit être effectivement élevé en France par une personne de nationalité française pendant une durée minimale de cinq ans. Cette période de recueil constitue une condition indispensable pour que la déclaration de nationalité soit recevable.
L’enfant peut engager cette procédure dès qu’il remplit les critères légaux, et notamment à partir de l’âge de 16 ans. Il doit alors déposer une déclaration de nationalité auprès du tribunal judiciaire compétent, en général celui de son lieu de résidence. Cette procédure ne confère aucun effet rétroactif, ni lien de filiation ou droit successoral. Elle reste indépendante de l’adoption, que le droit français n’accorde pas automatiquement aux enfants sous kafala.
Cette distinction est essentielle : la kafala n’est pas une adoption, mais elle permet, dans le respect des délais et des conditions posées par la loi, un accès régulier à la nationalité française, sans contournement des règles migratoires. Une clarification importante, notamment dans un contexte politique où ce dispositif fait l’objet de nombreuses idées reçues.
Une pratique protégée par le droit international
Le gouvernement rappelle également que le respect du cadre de la kafala s’inscrit dans les engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’enfance. L’article 20 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant signée à New York en 1989, reconnaît la kafala comme une forme de prise en charge alternative de l’enfant privé de famille.
Ainsi, toute volonté d’abolir ou de restreindre la kafala entrerait en contradiction directe avec le droit international, mais aussi avec la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considèrent depuis des années que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
Maintien de la kafala : une position politique assumée
En conclusion de sa réponse parlementaire, le gouvernement français précise qu’aucune réforme n’est prévue concernant l’article 21-12 du Code civil ni l’accord bilatéral de 1968. En dépit des appels à la révision de ce cadre par certains élus, Paris réaffirme son attachement à la kafala comme mécanisme de protection et d’accueil, dans le respect des procédures judiciaires et administratives existantes.
Ce positionnement est perçu comme une garantie de stabilité pour les familles algériennes concernées par ce dispositif. Il intervient également à un moment où le débat politique sur l’immigration est particulièrement tendu, à l’approche des élections législatives anticipées et dans un contexte européen marqué par la montée des droites radicales.
- La kafala judiciaire reste reconnue en France comme mode de tutelle légale pour les enfants algériens.
- Le regroupement familial par kafala est possible dans le cadre de l’accord franco-algérien de 1968.
- La naturalisation via kafala reste autorisée, mais sous conditions strictes (durée, lien non biologique, résidence effective).
- Moins de 30 cas de naturalisation sont enregistrés chaque année, selon les chiffres officiels.
- Aucune réforme de la loi ou de la kafala n’est envisagée par le gouvernement à ce jour.