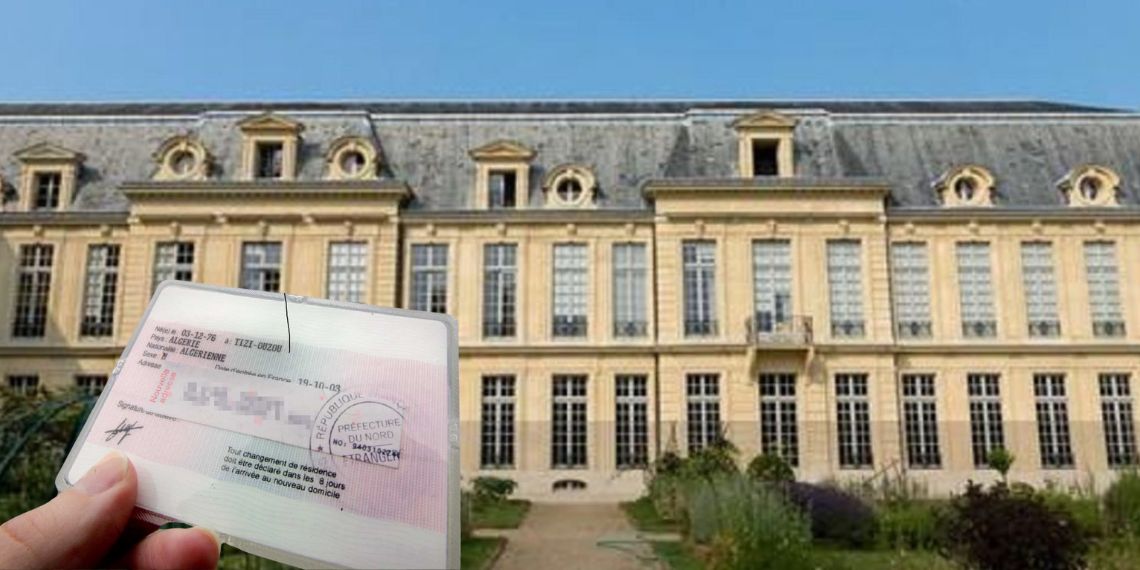La récente annonce de la préfecture de l’Isère marque une très mauvaise nouvelle pour les sans-papiers en France, avec la fin d’un dispositif vieux de seize ans permettant le dépôt collectif des dossiers. Cette rupture officialise un durcissement administratif qui pourrait compliquer considérablement les procédures de régularisation.
Depuis avril 2025, les sans-papiers de l’Isère ne peuvent plus compter sur l’intermédiation de la CGT pour déposer collectivement leurs demandes de régularisation. Ce changement met fin à une pratique instaurée il y a plus d’une décennie, qui facilitait les démarches et permettait une gestion centralisée, structurée et surtout accompagnée des dossiers. La fin de cet accord ne découle pas d’une évolution réglementaire globale, mais bien de l’application locale de la circulaire Retailleau.
Les conséquences ne se sont pas fait attendre. En effet, les dépôts doivent désormais être réalisés individuellement au guichet de la préfecture de Grenoble, sans tenir compte du lieu de résidence du demandeur. Les sous-préfectures de Vienne et La-Tour-du-Pin ne reçoivent plus de dossiers, obligeant nombre de demandeurs à parcourir de longues distances pour accéder aux services administratifs compétents.
Une mauvaise nouvelle pour les sans-papiers dans le contexte de la circulaire Retailleau
Le retrait de la CGT des procédures de régularisation s’inscrit dans un contexte plus large de réforme administrative initiée par le ministère de l’Intérieur. La circulaire Retailleau, publiée en début d’année, durcit les critères d’examen des dossiers de demande de titre de séjour. Elle vise un traitement individualisé et quantifiable des demandes, excluant toute démarche collective encadrée par un acteur syndical.
Les autorités affirment que ces nouvelles règles renforcent l’efficacité du traitement et visent à uniformiser les pratiques entre préfectures. Mais pour de nombreux observateurs, l’absence de coordination avec des acteurs de terrain comme les syndicats rend le processus plus opaque et plus difficile à comprendre pour les concernés.

Impact administratif et social sur les travailleurs étrangers en situation irrégulière
Le retrait du cadre collectif implique une série de conséquences pratiques, notamment l’allongement des délais de traitement, la surcharge des guichets préfectoraux, l’inégalité d’accès selon la localisation géographique, et surtout, la perte d’accompagnement pour les personnes les plus vulnérables.
L’ancien système, qui permettait le traitement groupé des dossiers, offrait une certaine cohérence dans l’interprétation des critères de régularisation. Avec le nouveau format, chaque dossier est traité indépendamment, sans appui syndical, exposant les demandeurs à une gestion plus stricte, voire inégale.
Les travailleurs concernés, souvent employés dans le BTP, la restauration, ou les services à la personne, doivent désormais naviguer seuls dans un système réputé complexe. Le cadre juridique des étrangers en France est connu pour ses multiples textes, décrets, circulaires et critères d’interprétation. Dans ce contexte, l’accompagnement administratif devient presque une condition d’accès aux droits.
Le rôle affaibli des structures intermédiaires dans l’accompagnement des dossiers
Pendant seize ans, la CGT des travailleurs sans-papiers a servi d’intermédiaire entre l’administration et les étrangers en situation irrégulière. Ce rôle allait au-delà de la simple transmission de documents : vérification des pièces, constitution des dossiers, orientation juridique, suivi des décisions.
En excluant ce maillon, l’administration place la charge de la régularisation sur les épaules de personnes qui, souvent, ne maîtrisent ni la langue, ni les procédures. Pour les préfectures, cela signifie également une hausse du volume de demandes incomplètes ou mal constituées, avec des effets secondaires sur la qualité et les délais de traitement.
Les syndicats et associations s’inquiètent aussi du risque d’exploitation accrue. Sans reconnaissance administrative, les travailleurs étrangers deviennent encore plus dépendants de leurs employeurs, qui peuvent exercer une pression sur leurs conditions de travail. L’absence de titre de séjour affaiblit la possibilité de recours en cas d’abus, ce qui alimente des dynamiques économiques parallèles et précaires.
Vers une généralisation du dispositif à d’autres départements
La rupture officielle annoncée dans l’Isère pourrait ne pas rester isolée. Selon plusieurs sources syndicales, des consignes similaires seraient en discussion dans d’autres préfectures. Si cette logique se confirme, les sans-papiers en France pourraient être confrontés à une restructuration complète des conditions de régularisation, accentuant les disparités régionales.
Ce changement de paradigme s’inscrit dans une stratégie administrative centralisatrice, où les procédures sont harmonisées mais perdent en adaptabilité. Il ne s’agit pas d’un nouveau cadre légal, mais d’une modification des pratiques internes au sein des préfectures, opérée sans débat parlementaire.
Le rassemblement prévu le 10 mai à Grenoble illustre la volonté des organisations concernées de demander plus de visibilité sur les effets concrets de cette évolution. Sur le terrain, les témoignages se multiplient autour des difficultés rencontrées, signalant une phase de transition particulièrement délicate pour des milliers de travailleurs en situation irrégulière.