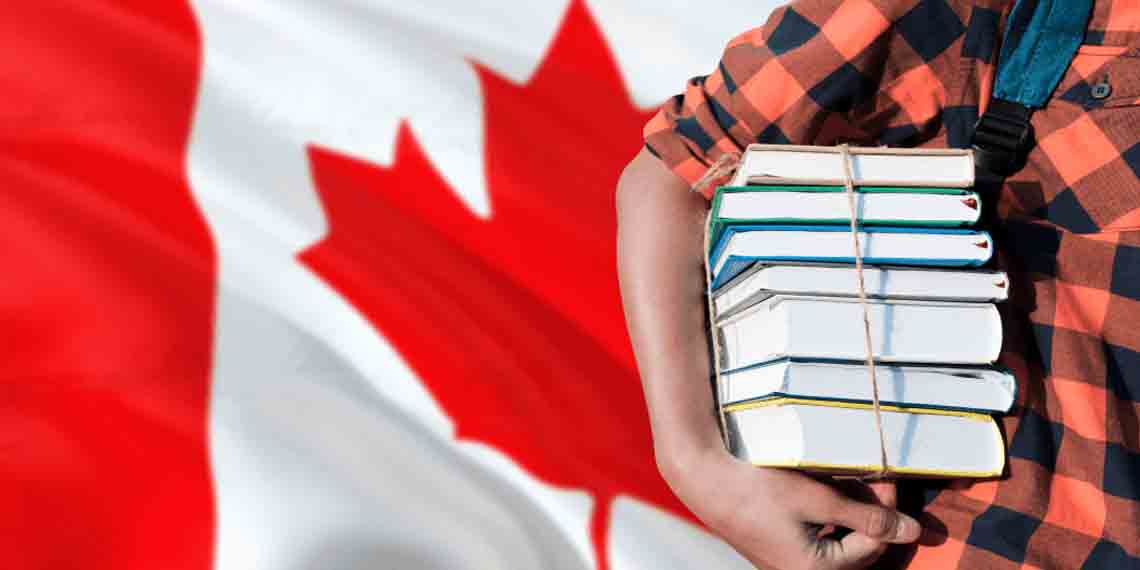Ottawa restreint l’accès au permis de travail post diplôme, La crise des inscriptions universitaires, frappe de plein fouet les étrangers, dont de nombreux étudiants algériens au Québec, avec une baisse inédite qui dépasse parfois les 50 %, Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Enseignement supérieur
La réforme du permis de travail post diplôme (PTPD) prive des milliers d’étudiants étrangers, notamment algériens, de la possibilité de rester au Québec. Une décision fédérale qui fragilise la formation professionnelle et accentue la pénurie de main-d’œuvre.
Une réforme fédérale qui bouleverse les étudiants algériens au Québec
Depuis novembre 2024, Ottawa a resserré les critères d’admissibilité au permis de travail post diplôme (PTPD). Ce document, crucial pour rester et travailler au Canada après ses études, n’est désormais plus accessible à la majorité des diplômés de formations professionnelles (DEP). Concrètement, sur 188 programmes recensés, plus de 100 ne permettent plus d’obtenir le PTPD, selon l’organisme Éducation internationale. Parmi eux :
- 40 métiers en pénurie au Québec,
- 14 programmes jugés prioritaires par le ministère de l’Éducation,
- 5 formations liées à la construction, un secteur vital pour l’économie.
Une mesure qui touche de plein fouet les étudiants étrangers, dont une part importante vient d’Algérie, attirés par la promesse d’une insertion professionnelle rapide au Québec.
Des investissements publics menacés
Les conséquences sont déjà visibles. Le gouvernement du Québec a récemment injecté 4 millions de dollars dans la modernisation du programme de transformation des métaux en fusion au Centre de formation professionnelle Le Grand Fjord (Saguenay).
Ce programme, au taux de placement de 100 %, comptait sur des étudiants étrangers pour répondre aux besoins urgents des fonderies. Sans accès au PTPD, ces profils risquent désormais de se détourner du Québec.
« On prive le Québec d’immigrants qui sont déjà formés, francisés et prêts à travailler dans des métiers essentiels », déplore Lysiane van der Knaap, directrice d’Éducation internationale.
Un contre-sens économique pour le Québec
Selon le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la mesure est un non-sens alors que la province affiche près de 100 000 postes vacants. La majorité de ces emplois nécessitent une formation professionnelle, et non universitaire.
« On a besoin de préposés aux bénéficiaires, de soudeurs, de machinistes. Si on veut construire des infrastructures comme le port de Contrecœur, il faut des diplômés issus de la formation professionnelle. Décourager ces étudiants, c’est se tirer dans le pied », alerte Daye Diallo, responsable des politiques de main-d’œuvre au CPQ.
Une incertitude qui décourage les candidats
Autre problème majeur : l’instabilité des règles. La liste des programmes admissibles au PTPD a déjà été modifiée en juin 2025, et pourrait encore évoluer en 2026.
« Le gouvernement joue au yoyo », regrette Mme van der Knaap, qui pointe un manque de cohérence entre Ottawa et Québec. Pour elle, cette réforme s’inscrit dans une stratégie de réduction rapide du nombre d’immigrants temporaires, plutôt qu’une gestion réfléchie des besoins.
Vers une bataille politique à Québec ?
Le dossier sera au cœur des consultations pluriannuelles sur l’immigration, prévues le 16 septembre 2025. Plusieurs acteurs du milieu éducatif et économique appellent le gouvernement du Québec à hausser le ton face à Ottawa pour défendre :
- une meilleure prise en compte des besoins de main-d’œuvre,
- la valorisation des programmes professionnels,
- et la place des étudiants francophones, dont les Algériens représentent une part importante.
Pour de nombreux étudiants algériens, la réforme est vécue comme un véritable coup de massue. Beaucoup choisissaient le Québec précisément pour sa formation francophone et la perspective d’un emploi stable après le diplôme.
« J’ai choisi un DEP en électromécanique pour travailler ici après mes études. Aujourd’hui, je me demande si je ne vais pas devoir repartir », témoigne Adel, 24 ans, originaire de Tizi Ouzou.
Entre rêves d’avenir contrariés et besoins économiques non comblés, le fossé entre les annonces fédérales et la réalité québécoise semble plus profond que jamais.