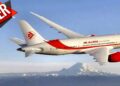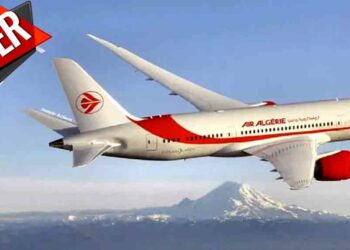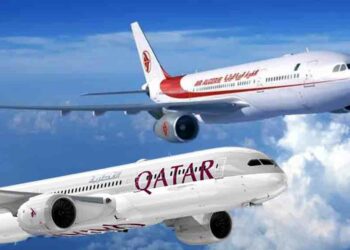Une rumeur virale qui affolait les réseaux sociaux : un tsunami serait sur le point de frapper la Méditerranée le 10 juillet 2025, La prédiction a circulé sur TikTok, YouTube ou encore dans des groupes WhatsApp, sous forme de vidéos mystérieuses et de prophéties apocalyptiques.
Mais le jour est passé, et rien ne s’est produit. Ni raz-de-marée, ni alerte sismique majeure. Alors, info ou intox ? Entre rumeurs en ligne et prévisions scientifiques sérieuses, il est temps de distinguer le vrai du faux.
Ce n’est pas la première fois qu’une prophétie apocalyptique circule sur la Toile. Cette fois, la Méditerranée était ciblée avec une date précise : le 10 juillet. L’idée : un raz-de-marée dévastateur devait s’abattre sur le littoral, frappant les villes de Nice, Marseille ou encore Cannes.
Les réseaux se sont enflammés. Pourtant, les spécialistes sont catégoriques. Aucune prédiction aussi précise n’est scientifiquement possible. Philippe Charvis, sismologue à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), est clair à ce sujet :
“La science, en l’état actuel des connaissances, est incapable de prédire un tsunami. Si c’était le cas, ça se saurait !”. Et pourtant, cela n’empêche pas les experts de surveiller attentivement les secousses sismiques dans la région. Car si on ne peut pas prédire un tsunami à la minute près, on peut identifier les zones à risque.
Une surveillance permanente en Méditerranée
Le bassin méditerranéen n’est pas un havre de paix géologique. Bien au contraire. Les scientifiques y scrutent chaque mouvement du sol. Une attention particulière est portée à certains endroits bien connus des volcanologues et géophysiciens. C’est notamment le cas des îles Éoliennes, au nord de la Sicile.
Dans cette région, surnommée The Smoking Land, les éruptions de gaz sous-marines sont fréquentes. L’UNESCO et le projet « One Ocean », mené par le photographe et explorateur Alexis Rosenfeld, y réalisent des observations régulières. L’objectif est simple : détecter les signes avant-coureurs d’un possible événement majeur, comme une explosion sous-marine ou un glissement de terrain pouvant générer un tsunami.
Francesco Italiano, responsable de la section de Palerme à l’Institut National de Géophysique et de Volcanologie (INGV), résume ainsi le risque : “Nous estimons que, selon un cycle naturel, il y a une grande explosion dans cette zone tous les 70 ans. Or, la dernière a eu lieu à la fin des années 1930.”
L’UNESCO le rappelle depuis 2022 : un tsunami en Méditerranée n’est pas une question de « si », mais de « quand ». Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, l’organisation parle d’un risque majeur pour les villes côtières françaises comme Marseille, Nice, Antibes ou Cannes. Et ce n’est pas une simple hypothèse : les modèles sismiques et les historiques de catastrophes renforcent cette thèse.
En 1908, un séisme dévastateur a frappé le détroit de Messine, entre la Sicile et la Calabre, suivi d’un tsunami. Bilan : plus de 200 000 morts. Un épisode tragique, souvent méconnu du grand public, qui a marqué les chercheurs par son ampleur.
Autre événement marquant : le glissement de terrain sous-marin au large de Nice en 1979, qui a causé une vague meurtrière. Ou encore, plus récemment, le tsunami de Samos en 2020, en Grèce, lié à un séisme de magnitude 7.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Méditerranée n’est pas une mer tranquille. Plusieurs éléments en font un terrain propice aux tsunamis. Des failles sismiques actives : en mer Égée, au large du Maghreb, en Italie du Sud… Ces zones peuvent générer des séismes puissants.
Des volcans sous-marins : Stromboli, Panarea, Pisciotta… Des éruptions ou effondrements sous-marins peuvent déclencher des vagues. Une mer semi-fermée : les côtes sont proches, ce qui réduit le temps d’alerte. Une vague peut atteindre la terre ferme en 10 à 15 minutes seulement.
Le changement climatique n’augmente pas directement les tsunamis, mais l’élévation du niveau de la mer accentue leurs conséquences. Face à ces constats, les autorités ne restent pas les bras croisés. L’UNESCO a mis en place le programme “Tsunami Ready”, qui vise à préparer les communautés côtières aux risques. Objectif : que 100 % des zones exposées soient équipées et formées d’ici 2030.
Des villes comme Cannes ont déjà obtenu cette certification. La commune dispose désormais de 340 haut-parleurs, d’un plan d’évacuation balisé et organise des exercices de simulation. D’autres villes françaises suivent le mouvement.
En parallèle, la France s’est dotée depuis 2012 du CENALT (Centre d’alerte aux tsunamis), qui surveille en temps réel l’activité sismique et océanographique en Méditerranée. Ce centre est capable de lancer une alerte en moins de 10 minutes après un séisme majeur.
Les experts s’accordent à dire qu’un tsunami d’au moins un mètre a de grandes chances de survenir dans les 30 prochaines années dans le bassin méditerranéen. Une probabilité élevée, mais qui n’implique pas une date précise.