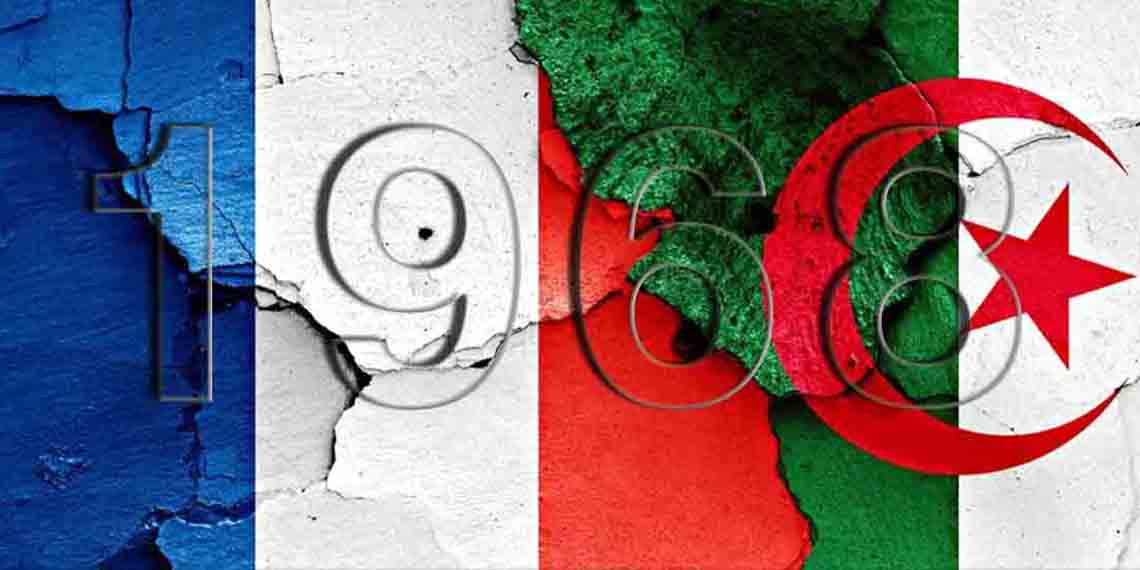Après le vote serré d’une résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, deux avocats parisiens plaident pour une révision constructive de ce texte fondateur, afin d’ adapter le droit au séjour des Algériens à la réalité migratoire actuelle, sans alimenter les tensions politiques.
L’obtention et le renouvellement d’un titre de séjour sont devenus un parcours semé d’obstacles pour de nombreux ressortissants étrangers, et plus particulièrement pour les Algériens. En cause, un cadre juridique ancien, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’a pas évolué au même rythme que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Dans une lettre ouverte adressée aux présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, publiée le 31 octobre 2025 sur le média Alwihda Info, les avocats Maîtres Fayçal Megherbi et Bernard Schmid appellent à une réforme équilibrée, “mais pas dans le sens de l’extrême droite française”.
Accord franco-algérien de 1968 face à des réformes ignorées
Mercredi dernier, l’Assemblée nationale française a ravivé un vieux débat en adoptant, à une voix près (185 contre 184), une résolution proposée par le Rassemblement national (RN) visant à remettre en cause l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet accord historique encadre, depuis plus de cinquante ans, la circulation, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France.
Soutenue par une partie de la droite républicaine et du groupe Horizons, cette adoption a été perçue comme une victoire symbolique pour l’extrême droite, mais aussi comme un nouvel épisode de tension entre Paris et Alger, déjà fragilisés par plusieurs différends diplomatiques récents.
L’accord franco-algérien, signé six ans après l’indépendance de l’Algérie, établit un régime dérogatoire pour les ressortissants algériens résidant en France. Il encadre la circulation, l’emploi et le séjour, notamment via la délivrance du certificat de résidence, une carte spécifique distincte des titres de séjour du CESEDA.
Bien que plusieurs avenants aient été ajoutés (1985, 1994 et 2001), le dispositif reste “gelé” par rapport au droit commun. Ainsi, de nombreuses réformes majeures du droit des étrangers, comme la loi du 7 mars 2016 ou la circulaire du 23 janvier 2025, ne s’appliquent pas aux Algériens.
Principale conséquence, ils sont exclus des cartes de séjour pluriannuelles (« Passeport Talent », « Travailleur saisonnier », etc.) et de certaines procédures de régularisation prévues pour d’autres nationalités.
L’appel de deux avocats pour une réforme juste et réaliste
Dans une lettre ouverte adressée aux présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, les avocats Fayçal Megherbi et Bernard Schmid, du barreau de Paris, dénoncent la dérive politique autour de ce dossier sensible. Ils rappellent que les Algériens ne bénéficient d’aucun privilège particulier en matière de séjour, contrairement à certaines idées reçues.
« L’accord de 1968 n’offre pas d’avantages excessifs, mais il a été figé dans le temps », expliquent-ils. « Il ne prend plus en compte la réalité des mobilités, ni les réformes du droit des étrangers intervenues en France ces dernières années. »
Des effets concrets sur la vie quotidienne
Selon les deux avocats, cette situation crée une inégalité de traitement qui fragilise les Algériens établis en France, qu’ils soient étudiants, travailleurs ou conjoints de Français.
Les étudiants algériens, par exemple, doivent toujours obtenir une autorisation provisoire de travail (APT) pour exercer une activité salariée — une procédure supprimée pour les autres nationalités.
De même, les ressortissants algériens ne peuvent pas invoquer l’article L. 313-4 du CESEDA, qui autorise une régularisation pour motifs humanitaires.
Autre particularité, la règle des dix ans de présence sur le territoire, abrogée du droit commun en 2006, reste en vigueur pour les Algériens ; elle permet d’obtenir un certificat de résidence « vie privée et familiale » après une décennie de séjour continu.
Ce que propose la réforme équilibrée suggérée par les juristes
Les avocats Megherbi et Schmid plaident pour une mise à jour pragmatique et équitable de l’accord franco-algérien, qui tienne compte de l’évolution des flux migratoires et de la réalité socio-économique.
Parmi leurs principales recommandations :
- Supprimer l’obligation de visa long séjour pour les Algériens conjoints de Français ou souhaitant exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
- Harmoniser les droits des étudiants et diplômés algériens avec ceux des autres ressortissants étrangers en France.
- Maintenir la possibilité de régularisation pour les personnes présentes sur le territoire depuis dix ans, un principe supprimé dans le CESEDA mais toujours défendu dans l’accord bilatéral.
Ces propositions visent à moderniser sans effacer, à adapter sans rompre : un équilibre nécessaire pour éviter que la question migratoire ne soit, une fois de plus, instrumentalisée politiquement.
Réformer, oui – mais sans tomber dans le rejet
Les juristes rappellent que toute révision de l’accord doit se faire dans un cadre de respect mutuel, loin de la logique de fermeture prônée par certains partis politiques. Car, selon eux, les Algériens ne sont pas des “privilégiés du séjour”, mais des partenaires historiques liés à la France par des décennies d’histoire commune, d’échanges et de mobilité.
« Réformer les accords bilatéraux, oui, mais pour les adapter à la réalité du XXIᵉ siècle, pas pour exclure », concluent-ils. Les deux avocats insistent sur une mise à jour « salutaire » mais équilibrée : « L’actualisation des accords ne doit pas emprunter le chemin de la fermeture et du rejet », écrivent-ils, soulignant que les Algériens ne sont « en réalité aucunement privilégiés du droit au séjour ».
Un appel à la raison diplomatique
Pour ces juristes, il ne s’agit pas de remettre en cause la coopération franco-algérienne, mais de l’adapter à l’époque. L’enjeu dépasse le droit administratif, il touche à la confiance entre deux sociétés liées par une histoire et des flux humains constants.
Alors que la résolution du Rassemblement national a été adoptée d’une courte majorité (185 voix contre 184), cette lettre ouverte réintroduit une voix juridique modérée dans un débat souvent politisé.
L’accord franco-algérien de 1968, s’il fut un symbole de coopération, est aujourd’hui un texte figé qui ne correspond plus aux besoins des deux sociétés.
La France et l’Algérie ont désormais le choix, moderniser ensemble leur cadre migratoire, ou laisser les extrêmes dicter le récit d’une relation historique qui mérite mieux que la défiance.
Ainsi, loin de toute posture partisane, cette lettre ouverte s’inscrit dans une démarche de lucidité et de justice. L’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas un vestige du passé, mais l’un des fondements vivants du dialogue entre les deux rives. Le réviser, ce n’est pas le renier, c’est lui offrir une seconde respiration, à la mesure des mutations politiques, sociales et humaines de notre temps.
Peut-être l’histoire retiendra-t-elle ce moment comme celui d’un passage entre deux générations? celle de 1968, qui portait encore la foi dans la fraternité des peuples, et celle d’aujourd’hui, qui cherche à réinventer une relation fondée sur la dignité, l’équité et la reconnaissance mutuelle. Mais une vérité demeure? les droits ne s’effacent pas au gré des vents idéologiques — ils se réécrivent dans la fidélité à la mémoire, et dans la constance du juste.